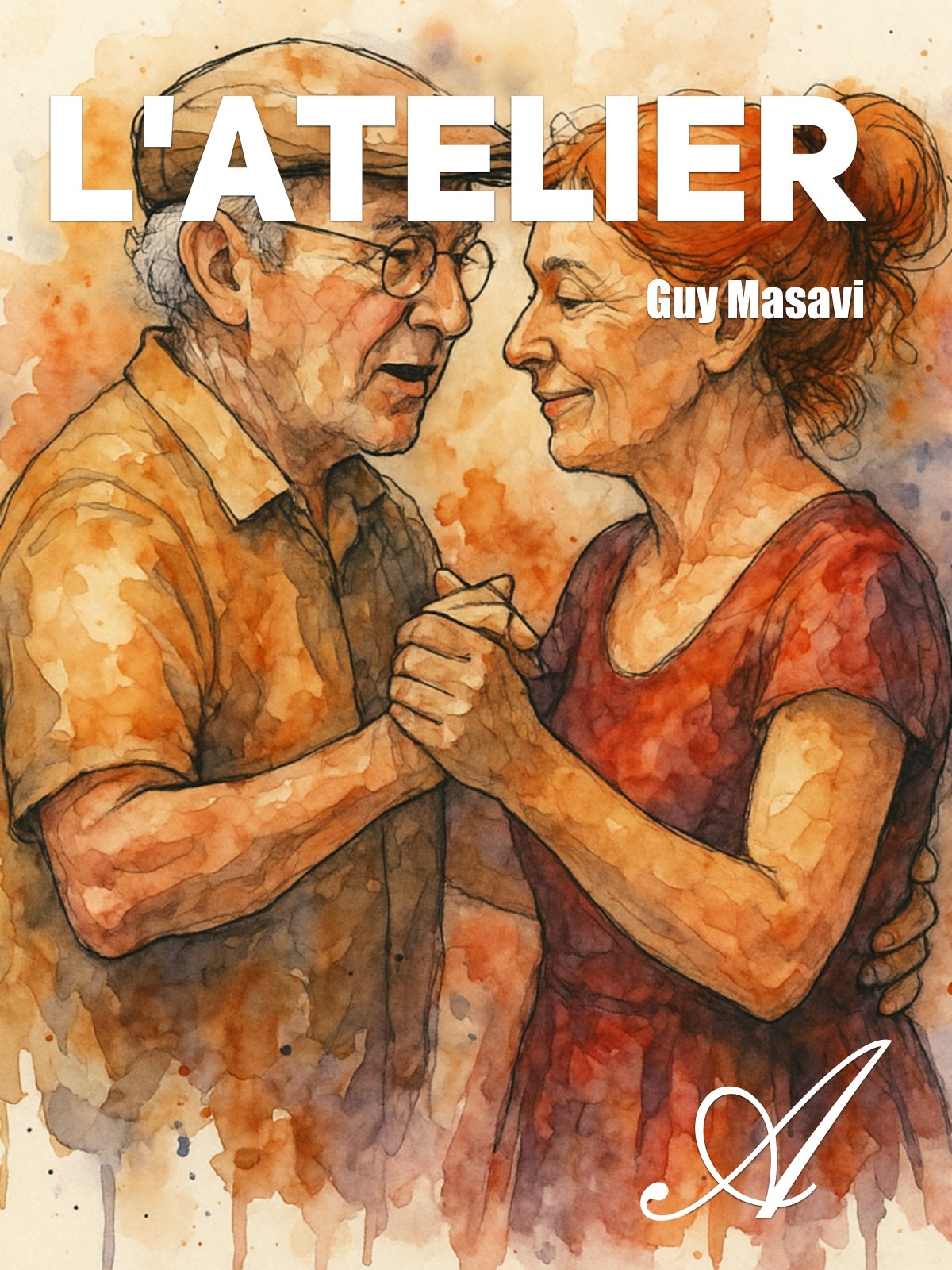J’ai poussé la porte d’un atelier de danse quelques mois après mon premier bal. Avant ça, j’avais couru les balfolks autour de Nîmes en suivant le fil d’un groupe qui m’avait littéralement happé : CABR’ E CAN.
CABR’ E CAN, ce n’était pas juste des musiciens. C’était une bande de passeurs. Un souffle d’air occitan levé sur les planchers. Leurs instruments semblaient taillés dans un autre siècle. Leur vitalité, elle, n’avait pas d’âge.
Ils étaient trois. Un grand gaillard, toujours coiffé d’un béret, le corps presque soudé à son diato ou à sa vielle à roue. Une femme, fine et droite comme une flèche, le souffle éclaté entre chant, flûte et hautbois, la tresse longue comme une rivière jusqu’aux genoux. Et un contrebassiste, taiseux, solide, avec son instrument géant d’un vert improbable.
Ils venaient d’un monde sans lignes droites. Un monde de chemins creux, de pas croisés et de bourrées à trois temps parmi cent autres danses. On aurait juré que le bois des parquets gardait la mémoire de leurs rythmes. Leur musique ne cherchait rien. Elle n’avait rien à prouver. Elle vivait, simplement.
La vielle ronronnait comme un chat, la contrebasse grondait comme un orage lointain, et le diato haletait de joie. Puis, sans prévenir, leurs voix jaillissaient, brutes, charnelles, provençales, entêtantes comme un vin qui mord les lèvres.
La femme s’appelait Chantal. Je m’en souviens comme on se souvient d’un feu de camp dans la nuit. Elle descendait de scène à chaque danse collective, souvent appelée par un regard complice du géant au béret. Et elle montrait les pas, pas comme on enseigne, mais comme on offre. Avec cette évidence du geste qui précède la parole.
Elle n’était pas qu’une maîtresse de danse, elle incarnait le mouvement. Elle traversait le bal comme une impulsion puis remontait sans bruit, sans cérémonie, reprendre sa place parmi ses compères musiciens.
Il y avait chez eux cette générosité inouïe des choses simples. Comme une histoire qu’on raconte sans la décortiquer. Une musique qui vous cueille par les jambes et vous laisse des souvenirs dans les oreilles. Une musique qui faisait danser même ceux qui croyaient ne pas pouvoir.
J’en étais…
Je revenais chaque semaine. Alès, Rousson, Anduze, Saint Christol les Ales. Le bal comme une respiration du samedi. Mais il manquait quelque chose. Un pas volé au hasard ne me suffisait plus. Je voulais comprendre ce que mon corps pressentait. Je voulais l’apprendre.
Je me souviens d’un bal à Saint-Anastasie et d’une femme aux cheveux écarlates. Pas un rouge criard, non. Un rouge de braise. Elle ne cherchait pas à séduire. Mais tout en elle captait la lumière. Je l’avais déjà vue, une ou deux fois, effleurée du regard simplement. Mais ce soir-là, dans un fandango, elle devint inoubliable.
Le fandango…
Danse bondissante et vive qui nous vient du grand ouest. Elle ne laisse pas de place au flou et trace une ligne nette : d’un côté, les débutants ; de l’autre, ceux qui dansent comme on respire.
Moi, je suis resté en bord de piste. Car on n’entre pas dans un fandango sans savoir. Mais à la regarder, je ne regrettais rien. Elle ne dansait pas. Elle dessinait dans l’air. Chaque geste semblait couler depuis le violon, traverser ses épaules, se répandre dans ses jambes, puis ricocher sur le parquet. Chez elle, rien de trop. Rien d’imité.
Une simplicité bouleversante. Une présence fluide, rare.
Et puis le hasard, toujours lui. Je posai mon sac près du sien. L’invitai une ou deux fois. Une polka. Une valse, peut-être. Je ne sais pas si elle se souvient de moi. Mais moi, je m’en souviens.
Comme cette bribe de conversation, glissée entre deux rires de son groupe qui fut une clef : un atelier de danse à Garon. Non loin de chez moi. Ce fut une invitation, sans intention, mais inoubliable.
La semaine suivante, j’y étais.
Une salle un peu défraîchie, accolée à l’église. Une quinzaine de personnes déjà en cercle. Aucun silence pesant à mon arrivée. Aucun regard qui jauge. Juste des sourires. Et Cristina, la maîtresse de danse, qui s’avance vers moi, les bras ouverts. Comme si elle m’attendait. J’étais des leurs. Pas encore par les pas. Mais déjà par le cœur.
La danse du jour était le hornpipe.
Je ne sais pas ce qui m’a pris. Je suis entré dans le groupe sans timidité. Peut-être l’envie d’écouter mon corps autrement, ou cette musique-là. Vive, tranchante, avec dans ses notes la mer d’Irlande, ses ports rugueux, ses planchers mouillés.
Dans la salle, la flûte et l’accordéon des musiciens faisaient le job. Ils nous baladaient en mer d’Iroise, debouts, vacillants, embarqués. Le hornpipe est une danse née pour tenir debout quand le monde tangue. Et moi, je tanguais déjà. Mais dedans.
Je ne pris pas garde à la partenaire qui me saisit la main face à moi. Trop concentré par les premières instructions. La danse commençait par deux pas de scottish à ma gauche puis deux à droite suivie d’un pas où plutôt d’une pause instable : Le croisé suspendu.
Pied droit devant le gauche. Pause. Retour. Puis l’inverse. Un enfer pour moi, tout commençait bien mal. Je faillis chuter…
De vieux souvenirs de mes études universitaires remontèrent, peut-être pour me rassurer. J’avais alors le menton glabre, mais les cheveux touffus et longs.
Que me disaient mes vieux restes de cours d’anatomie ?
Pas de panique !
Le cortex préfrontal s’active. Chef de projet. Veilleur de l’inédit. Il segmente, anticipe, découpe. Il compte à ma place. Un-et-deux-et. Il doute. Comme toujours.
Un peu plus haut, le cortex prémoteur esquisse. Le geste n’est encore qu’une intention. Un rêve de mouvement. Un trait dans le brouillard que la musique dessine doucement.
Puis le cortex moteur s’enclenche. Il donne les ordres. Il transforme l’idée en tension musculaire. Mais tout est encore sous contrôle. Je pense. Je fais. Je doute.
Alors je lève les yeux pour découvrir enfin que ma partenaire d’en face, celle qui me tient la main, n’est autre que ma danseuse de Fandango.
Elle est là. Elle sait bien sûr. Alors je vais l’imiter. Et mes neurones miroirs s’activent. Traducteurs silencieux entre regard et muscle. Mon corps fait ce qu’il voit. Avant même que j’aie décidé. Le cortex pariétal ajuste.
Elle avance le pied droit, je sais que c’est à mon gauche à faire de même. Parfois je me trompe, vieille histoire de latéralisation tardive. Mais j’apprends.
En l’imitant, je me trace.
Et pendant ce temps, le cervelet, en coulisse, affine, corrige, compense. Luthier invisible. Il accorde sans bruit.
Et je recommence.
Encore.
Encore.
Vient ce putain de croisé suspendu ! Ce moment minuscule les jambes emmêlées.
Les canaux de l’oreille interne sentent la gravité. Ils me disent si je tangue. Je corrige ou je tombe. Mais je recommence. Parce que je le sais : le geste s’installe à force de retours. Le cerveau apprend par frottement. Par usure douce. Il creuse un sillon. Même à soixante-huit ans. La plasticité existe encore. Moins flamboyante, mais plus obstinée. Elle façonne. Elle coud.
Je reprends les pas latéraux.
Je recroise mes jambes, haï !
J’ancre le rythme. Et dans l’ombre, les ganglions de la base, réseau profond au centre de mon cerveau, reconnaissent la boucle. Ils la gravent dans mes muscles. Le réflexe naît. Pas tout à fait encore, mais il se prépare.
Puis vient une pastourelle où l’on se croise, puis une autre où l’on revient à sa place. Et l’hippocampe au fin fond du cortex, archiviste discret, trace ses cartes : gestes, lieux, transitions. Il ancre les phrases musicales. Il me guide, dans la danse, dans l’espace.
Puis vient le temps d’une promenade, mains croisées devant avec celles de ma partenaire. Quatre petits pas sautillés. C’est presque rien. Mais le corps dit :
« Je me souviens. T’arrives au bout »
Mais je recommence.
Encore.
Encore.
Le même motif. La même boucle. Et un jour, sans prévenir, je sais que je ne compterai plus. Je ne penserai plus. Le préfrontal quittera la passerelle. Le cortex moteur jouera sa partition sans bruit. Le cervelet rectifiera en silence. Les ganglions de la base dérouleront la séquence.
Et moi, je danserai. Je ressentirai quelque chose de neuf. De vrai. Le plaisir. Pas celui de réussir. De flotter dans la musique. Sans friction. Sans analyse. Sans langage.
Je sourirai parce que je saurai et je me dirai :
Des circuits se sont formés et ce vieux corps, ce cerveau abîmé, peuvent encore inventer. Même à mon âge. Même dans cette phase de la vie où l’on ne parle que de perte.
Mais la perte n’est jamais toute l’histoire. Il lui reste cette faculté secrète de se remodeler. De créer de nouveaux chemins. Plus lents. Plus profonds. Et tant que je recommencerai, même lentement, même maladroitement, même fatigué, mon cerveau dansera avec moi.
Et peut-être, dans un repli minuscule de mon hippocampe, au bord d’un souvenir silencieux, je sentirai encore la mer d’Irlande battre longtemps encore contre mes tempes.